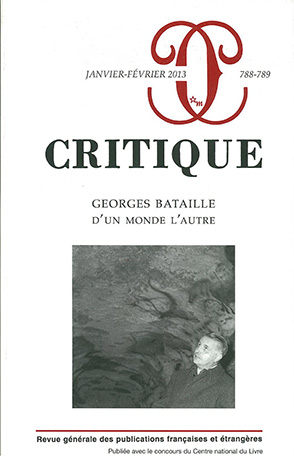Diverses manifestations, en 2012, ont salué le cinquantenaire de la mort de Bataille : à Vézelay, une série de conférences du printemps à l’automne : à Paris, une journée d’étude au Centre Georges Pompidou (le 1er juin), et un colloque en Sorbonne, où tout finit comme juste (les 7 et 8 décembre). Diverses publications aussi.
On doit aux patientes recherches de Marina Galletti de pouvoir lire des textes inédits, qu’elle a retrouvé dans les fonds Bataille et Carrouges de la BNF. Datant du début des années trente, les dix-sept feuillets auxquels on peut attribuer le titre « Définition de l’hétérologie » ne modifient pas de fond en comble notre vision de cette discipline inventée par Bataille. Mais ils en font nettement ressortir deux de ses enjeux stratégiques. En construisant « une science de la partie exclue », la science paradoxale de ce qui est « irréductible à l’assimilation rationnelle », et en y incluant le sacré polarisé entre pur et impur, Bataille cherche, d’une part, à faire échapper la religion à « toute évolution purifiante », qui prétendrait la dégager du « cloaque initial » dans lequel se mêlaient le pur et l’impur, le sacré droit et le sacré gauche. D’autre part, il prétend aboutir à une nouvelle approche de la lutte des classes, non plus fondée sur l’analyse des rapports économiques de production, mais sur la description de la division polarisante entre classes hautes et basses, et des liens de répulsion / attraction qui se tissent entre elles. Or c’est à ce point que le texte s’arrête abruptement : comme si Bataille pressentait que son analyse de la division sociale, qui en vient à s’appuyer sur le système indien des castes, n’avait pour l’heure rien d’assez substantiels à proposer, pour ce qui est de la situation en Europe, à la dialectique marxiste ? – Par ailleurs Marina Galletti a publié, et là encore commenté, trois lettres de Bataille à Carrouges, datant de 1939. L’une décrit avec précision le protocole à suivre pour se rendre, depuis Paris, à une rencontre de la société secrète Acéphale dans la forêt de Marly. La deuxième en définit le sens – produire une « contagion brûlante » entre des hommes d’un nouveau genre, aptes à « apercevoir le pire », et donc la guerre imminente, « comme une réalité à [leur] mesure ». Et la dernière, très belle, définit une exigence radicale : « Il faudrait […] arracher de soi les dernières guenilles philosophiques et véritablement devenir nu. Nu comme un chien qui crève seul ».
Les Nouvelles Éditions Lignes ont redonné à lire deux des plus célèbres textes de Bataille. D’abord, en 2010, la fameuse « Discussion sur le péché » – qui eut lieu en mars 1944 chez Marcel Moré -, assortie d’une postface de Michel Surya. Lequel présente avec érudition les personnes présentes – non sans rappeler l’importance des absents (les surréalistes) –, mais n’éclaire qu’assez peu le fond du débat, faut, notamment de considérer que la position critique de Sartre puisse enfermer la moindre onde de pertinence, ou de se demander en quoi le péché vaut aussi chez Bataille comme « antidote essentiel contre l’ennui ». Signalons au passage la réédition de la collection « Tel », de la biographie de Bataille par le même Michel Surya, parue d’abord en 1987 chez Séguier, avant d’être reprise en 1992 chez Gallimard, et dont on doit regretter qu’elle n’ait pas été révisée pour tenir compte de ce qui a pu être corrigé ou précisé par la recherche entre 1992 et 2012.
En 2011 a été réédité l’article « La notion de dépense », accompagné d’une postface de Francis Marmande. Après avoir rappelé les lectures de Bataille qui en 1931-1932 ont pu en préparer la rédaction, il relit d’abord l’article au regard du sommaire du numéro de la Critique sociale qui l’accueille. Ce qui lui permet de faire dialoguer avec la note que Bataille, dans le même numéro, consacre au Voyage au bout de la nuit, où il loue notamment « l’échange de vie pratiqué avec ceux que la misère rejette hors de l’humanité » : dans une forme littéraire de don et contre-don, Céline se vouerait aux miséreux, hors des chemins battus de la compassion ou de l’acceptation chrétienne, pour que la misère en retour lui soit offerte à écrire. Marmande fait observer que le roman que Bataille achève en 1935 conteste radicalement ce type d’échange : « Rien ne pouvait faire […] que je sois un ouvrier du pays et non un riche français en Catalogne pour son agrément », lit-on dans le Bleu du ciel. Ayant ainsi « désorienté » la lecture de l’article de 1933, texte théorique qui consonne avec un roman de Céline, et non point de Bataille, il la réoriente en le restituant entre son amont (le style des textes de Bataille dans Documents, auquel l’écriture de « La notion de dépense » emprunte encore ici et là) et son aval : la Part maudite, qui paraît en 1949. On peut regretter à ce point que cette postface n’engage pas le débat avec les objections que Jean-Joseph Goux a pu formuler dans Frivolité de la valeur. Essai sur l’imaginaire du capitalisme (Blusson, 2000). Je les rappelle : l’analyse bataillienne de la dépense improductive présente certes des allures anticapitalisme, à la Marx et à la Max Weber, une logique d’accumulation centripète et sérieuse, voire ascétique. Or le capitalisme qui nous entoure se propose désormais comme un monde et un monde de consommation, ou de dépense pas toujours productive, ou de gaspillage, illimités, volontiers somptuaires et ostentatoires. Même si la différence entre consumation (qui comporte une dimension sacrificielle) et consommation (avant tout hédoniste) conserve un sens, la notion de dépense demeure-t-elle encore pertinente pour penser une autre économie généralisée… que celle de la part gâcheuse de la mondialisation ? Peut-on par exemple s’en servir, se demande, en passant, Christian Prigent, pour appréhender le monde d’après le travail que certains – André Gorz, par exemple – voient se dessiner ?
Enfin, dans l’ordre des monographies critiques, les mêmes Éditions Lignes ont publié deux essais. Sous le titre le Pur Bonheur. Georges Bataille (2011), Francis Marmande a pour l’essentiel repris, réaménagé, et complété d’anciens articles, notamment une importante lecture du roman de 1950, l’Abbé C. De son côté, dans Bataille cosmique, Cédric Mong-Hy tente de reconsidérer la notion de dépense (encore elle), telle qu’elle se présente dans et autour de la Part maudite. Son originalité consiste à se placer sur un terrain peu étudié : celui des rapports de Bataille à la science. Cédric Mong-Hy soutient qu’à partir de 1934, Bataille a peu à peu « intégré en profondeur » une réflexion de l’ordre de la physique « sur les conséquences bio-anthropo-sociales du rayonnement solaire » ; il aurait ainsi opéré une « reconversion épistémologique d’envergure en faveur de la science » (le Bleu du ciel, p. 11 et 14), sous l’influence de son ami le physicien Georges Ambrosino, rencontré précisément en 1934, et qui le pousse probablement vers certaines lectures, dont témoignent ses emprunts à la Bibliothèque nationale – par exemple les Principes de la mécanique quantique de Paul Dirac, la Notion de corpuscules et d’atomes de Paul Langevin, etc. Mais surtout, Ambrosino fait comprendre à Bataille l’importance de la notion d’énergie (qu’étudie la thermodynamique), « paradigme unificateur qui permet d’envisager sous une vision globale l’unité et la diversité des phénomènes naturels » (BC, p.34). Or, l’« économie générale » que Bataille veut développer dans la Part maudite se fonde sur « la dépendance de l’économie par rapport au parcours de l’énergie sur le globe » : l’analyse économique ne saurait donc être séparée de l’étude scientifique de l’énergie dans la nature, ou plus précisément dans la biosphère, terme que Bataille dit reprendre d’un savant soviétique, Vernadsky. Mais quelle est la loi fondamentale de la biosphère ? Vernadsky : la biosphère est la création du Soleil. Bataille : « Nous ne sommes au fond qu’un effet du soleil. » C’est donc sur un Bataille écologue (non pas écologiste), penseur de l’économie universelle à l’intérieur de l’univers physique, que l’accent est mis. Et notamment, dans la seconde partie de l’essai, qui revient sur la théorie de la « composition des êtres » que Bataille édifie, et dont une première formulation se trouve dans l’article intitulé « Le Labyrinthe » (1935-1936). On y lit : « tout élément isolable de l’univers apparaît toujours comme une particule qui peut entrer en composition dans un ensemble qui le transcende » ; aucun être n’est isolé : du simple au complexe, les êtres se composent en une immense pyramide. Cédric Mong-Hy voit dès lors dans Bataille un précurseur de la théorie de la complexité qui apparut dans les années 1950 chez Teilhard de Chardin (la foi en plus, certes) et chez Edgar Morin : rapprochement assez périlleux. Mais surtout, il soutient qu’on a tort de considérer, même si Bataille y invite avec insistance, que la dépense se fait en pure perte, sans finalité aucune ; en fait, Bataille montrerait que chez l’être humain la dépense aboutit à « […] la conversion de son énergie physique et biochimique en culture » (le Bleu du ciel, p.87). L’excédent d’énergie aboutirait in fine à de la production intellectuelle. C’est donc à un changement de point de vue que Cédric Mong-Hy appelle : cesser de considérer l’excès comme une notion à connotations strictement érotiques ou mystiques, le concevoir plutôt comme une part d’énergie qui se prêterait aussi à la structuration des informations. Il reste qu’une telle redéfinition de la dépense et de l’excès ne convient guère à d’autres phénomènes, pourtant essentiels, dans lesquels ils se déploient, comme le rire, les larmes ou la jouissance physique. Cédric Mong-Hy n’envisage pas cette objection, et donc pas non plus celle de l’éclatement des notions qu’il place au cœur de son enquête : il n’est pas sûr que Bataille ait réussi à articuler les différents savoirs et les différentes expériences dont il s’inspire, ni même qu’il l’ait voulu. La science n’est pas pour lui un point de référence plus stable (moins glissant) et moins discutable qu’un autre, et il lui arrive plus d’une fois de critiquer vivement la posture du savant : trop patiente, elle manque d’intensité, de frayeur, de douleur.
La dernière parution importante que nous évoquerons date de l’année 2011 : il s’agit du premier numéro des Cahiers Bataille. De façon générale, comme il est de règle dans ce type de publication, c’est une attitude de profonde empathie qui domine. Certes, ici et là sont soulevés certaines difficultés : « Quelle posture, se demande Dominic Marion, peut prendre le lecteur devant une écriture qui ne peut se fonder dans un projet sans se trahir », et qui procède en « avançant des notions qui se dévaluent à même leur formation », au point de risquer de « ruiner la complicité communicationnelle » (« Figuration et irreprésentable : à propos d’une économie du non-savoir », p. 175) ? C’est dessiner avec justesse la ligne de crête sur laquelle marche non sans vertige tout lecteur de Bataille. On retiendra aussi, dans un très bel entretien de Christian Prigent avec Sylvain Santi, le jugement nuancé et profond que l’écrivain porte sur les poèmes de Bataille. D’un côté, il apprécie leur mélange « d’en plus (une exaltation sauvagement “mystique”) et d’en moins (la trivialité lexicale non poétique, les traits frontalement aphoristiques », mélange qui leur confère une force de provocation rare, laquelle permit à la poésie à la fois de « se désengluer de l’idéalisme post-romantique », de rompre avec la vieille tentation lyrique du liant dont le surréalisme lui-même ne s’était pas toujours gardé, et de se situer au cœur d’une contradiction décisive : « ne pouvoir vivre sans représenter sa vie / ne trouver dans aucune représentation formée l’exacte résonance de l’expérience qu’il [le sujet, le poète] fait du “réel” de cette vie », c’est-à-dire de « l’éclat inarraisonnable de “l’instant vécu” » (« Retour à Bataille », p. 20, 21, 30). De l’autre, Prigent se déclare un peu déçu par l’« alliance de déclarativité et de rhétorique » que manifestent ces brefs segments « gnomique[s] et oratoire[s] » organisés par l’anaphore, peuplés d’universaux abstraits (le ciel, l’amour, la nuit…) et dépourvus de « dispositif prosodique spécifique » (ibid., p. 24-25). Le geste poétique de Bataille vaudrait donc par-delà tel ou tel de ses poèmes : Prigent le revendique, non pas comme une influence, mais comme une autorisation – un moyen de devenir, à son tour, un auteur.
Dans ce premier numéro des Cahiers Bataille, on retrouvera des réflexions critiques de trois types. Plusieurs études se fondent sur un va-et-vient entre la vie et l’œuvre. La meilleure part revient à l’enquête biographiques (au sens large : vie et circonstances) dans la présentation par Michel Surya de la « Discussion sur le péché », on l’a dit, et aussi dans l’étude que Georges Sebbag consacre à « Breton, Bataille et la guerre d’Espagne ». Cette guerre, selon lui, « tous deux l’éluderont politiquement » (p. 153). Le premier, enchanté par les Canaries et en partance pour le Mexique, « rate en quelque sorte la révolution en Catalogne ou en Espagne » (p. 150). Le second, avant même qu’elle n’éclate, conçoit une « autre guerre d’Espagne, érotique et tragique, nietzschéenne et sacrificielle, bouleversante et apolitique », qui serait dépeinte dans le Bleu du ciel (1935) ; et dans les pages de sa « Chronique nietzschéenne » (Acéphale, juillet 1937) consacrées à la représentation de Numance par Barrault, Bataille refuse de projeter l’actualité espagnole sur la tragédie Cervantès. Autant cette analyse me semble convaincante pour ce qui est de 1937 – soit après la déception liée à l’échec du mouvement Contre-attaque –, autant je doute qu’elle rende justice à la portée politique du Bleu du ciel : certes, en apparence les « convulsions de l’érotisme l’emportent sur les manigances révolutionnaires » (ibid., p. 147), mais, sur un autre plan que celui de l’intrigue, Bataille cherche à la fois une exploitation politique de l’explosive énergie érotique, et la mise en récit de mythes révolutionnaires de gauches aptes à s’opposer efficacement à la force des mythes fascistes. – De son côté, Frédéric Aribit donne une étude aussi scrupuleuse qu’audacieuse du pamphlet « Un cadavre » orchestré par Desnos et Bataille contre Breton en 1930. Il suggère notamment qu’en faisant de Breton – d’ailleurs représenté couronné d’épines dans le célèbre photomontage de Boiffard – un substitut du Christ, Bataille l’insère dans la série de ses propres projections œdipiennes traumatiques, à la suite du père paralysé et du supplicié chinois aux cents morceaux ; mais si le supplicié fascine Bataille, Breton est voué à subir un meurtre symbolique : le pamphlet vaut comme un crachat à sa face.
Dans quatre autres articles se pratique une critique plus immanente au texte (ou aux textes) sur lequel elle s’attarde. C’est ainsi que Vincent Teixeira étudie en détail les huit lithographies par André Masson qui illustraient l’édition originale d’Histoire de l’œil en 1928 : leur succèderont six gravures par Hans Bellmer en 1947, et, pour une réédition en 1976, huit dessins au crayon de l’artiste japonais Kuniyoshi Kaneko, qui sont reproduits dans ce Cahier Bataille. Vincent Teixeira a aussi traduit, avec Rieko Shimizu, quelques pages où Kaneko s’explique sur sa fascination pour Bataille : « est-ce moi qui dessine Edwarda ? ou bien deviens-je Edwarda quand je dessine ? » (p. 226). Koichiro Hamano se concentre quant à lui sur le début du Bleu du ciel, intitulé, de façon curieuse dans un roman, « Introduction », et il montre comment y est introduit, en effet, un motif majeur, celui du cadavre maternel maltraité, conformément à l’anthropologie mythologique de Bataille, qui veut que l’homme nie la Terre-mère à laquelle il s’arrache. Nulle surprise dès lors si Jean-Louis Cornille, relisant le dernier roman de Bataille, Ma mère, peut superposer le viol de la mère dans une forêt, et la découverte d’images sexuelles par le fils dans la bibliothèque paternelle : à la conception biologique dans les bois répond ainsi une seconde naissance dans la bibliothèque, placée elle aussi sous le signe du vertige et de la violence. Cornille l’interprète comme une scène symbolique, qui révélerait à quel point Bataille lui-même, en tant qu’auteur, se sent voué à amplifier le désordre des livres, par le biais d’une « intertextualité débordante » (« Bataille entre boudoir et bibliothèque », p. 92). Si les récits et romans de Bataille font ainsi l’objet d’études attentives, il en va de même pour deux groupes d’« essais » : Felice Ciro Papparo s’intéresse aux textes de ces dernières années de la vie de Bataille, qui, autour des découvertes faites dans la grotte de Lascaux, méditent sur l’animalité et sur l’art. Muriel Pic propose une approche incisive des textes de Bataille qui, entre 1943 et 1945, s’écrivent à partir de la Seconde Guerre, c’est-à-dire pour en partir, s’en séparer, lui échapper : l’Expérience intérieure, Le Coupable, etc., manifestent une étrange « négation de l’actualité » (« Le péril de l’incommensurable », p. 156). Bataille prend le risque d’ignorer la guerre, dans une expérience intérieure qui, pratiquant l’oubli actif (au sens nietzschéen) des circonstances, refuse l’aliénation qu’elles imposent. Il s’agit de s’exposer à l’inactuel, de tenter d’échapper au destin que semble être la guerre en lui opposant l’ouverture de l’avenir et de la chance (le ciel comme espace d’indétermination), et de ménager sa place de l’incommensurable, c’est-à-dire à ce qui n’entretien aucun rapport avec une économie de la guerre (qui la perd ? qui la gagne ? qui y perd ? qui y gagne ?). Mais cette réhabilitation de ce qui n’a aucune valeur marchande (le ciel, les étoiles, le temps qu’il fait…) amène aussi à Bataille à réintroduire le thème de la dépense improductive – qu’il n’applique certes pas à la guerre sans effet de scandale.
Seuls deux articles ont l’audace d’embrasser l’ensemble de l’œuvre. Chiara di Marco commente en philosophe l’existence selon Bataille, cette « dimension interdite, a-logique de l’être humain » (« “Moi, j’existe”. Connaissance et existence », p. 98), espace labyrinthique qui, contre Hegel, se découvre par-delà le savoir. Elle montre un Bataille qui se découvre par-delà le savoir. Elle montre un Bataille qui aurait dessiné « la direction d’un humanisme intégral », dans lequel l’homme de l’Occident moderne, châtré par la raison, retrouverait son « côté obscur, dissimulé au fond même de notre être ». Et du coup elle propose une belle interprétation de la fin d’Histoire de l’œil : au prêtre qu’il vient d’occire dans une église de Séville avec Simone et le narrateur, Sir Edmond arrache un œil, pour marquer « l’évanouissement de la puissance visuelle du regard théorétique », œil platonicien, œil de la conscience, œil de Dieu ; cet œil qui a « oublié sa matérialité », une fois plongé – mort – dans la vulve de Simone, « ne voit rien, n’arrive pas à pénétrer le fond irrationnel de la vie, le côté féminin, gauche de notre être » (ibid, p. 113). Quant à Jean Pierrot, dans une excellente contribution intitulée « Bataille et le sensible », il analyse l’esthétique générale de Bataille, c’est-à-dire le rôle majeur attribué à l’activité des sens, à la sensibilité, à l’affectivité. Qu’est-ce qui fait fondre cette esthétique générale ? La revalorisation du corps contre l’esprit (on se souvient de la colère de Troppmann, dans le Bleu du ciel, contre le philosophe intellectualiste qu’est M. Melou) ; la place capitale accordée au dégoût (face à l’excrémentiel et face au sexuel, qui lui aussi implique « l’orifice de l’ordure ») dans la définition même de l’homme se différenciant de l’animalité ; mais aussi la fonction paradoxale du dégoût comme catalyseur du plaisir, et la définition de l’être moral souverain (hypermoral, si l’on préfère) comme celui qui a « le courage […] de surmonter son dégoût » (p. 120)… À quelles lois précises obéit l’économie de la sensation que Bataille explore sur cette base ? Premièrement, la qualité d’une sensation, contre cet affect fondamental pour Bataille qu’est l’ennui, dépend de son intensité et d’un effet de contraste ou de rupture. De plus, l’intensité tend à être recherchée à son summum, dans l’acte sexuel ou mieux encore dans l’extase de type mystique, l’excès se donnant alors comme le dépassement rêvé de ce seuil supérieur d’intensité. Enfin, dans les états extrêmes, plaisir et douleur s’équivalent et cessent de se différencier, en une « ambiguïté fondamentale » qui fascine Bataille, notamment dans la photographie du supplice des Cent morceaux. Ainsi fondée, ainsi réglée, l’esthétique générale de Bataille ne peut qu’accorder le plus grand rôle à la notion d’expérience, non pas scientifique, évidemment (quoi que Bataille donc ait pu savoir de la thermodynamique), mais intervenant au niveau de la sensation et du sensible (non du réflexif ou du rationnel), et sur le plan, ou la pointe, de l’instant (et non pas de la durée d’un protocole expérimental).
Jean Pierrot regrette qu’il n’y ait « peu de travaux concernant spécifiquement la réflexion esthétique » de Bataille (p. 116). Pour travailler à combler cette lacune, deux méthodes semblent possibles. L’une, très empirique, consiste à faire ressortir par contraste la spécificité de l’esthétique de Bataille. Peut-être est-il temps de délaisser les confrontations usuelles avec Breton, Aragon, Leiris, Klossowski, etc. J’ai ainsi opposé à Histoire de l’œil le grand succès « érotique » de la même année 1928, publié chez Gallimard, aussitôt recensé dans la NRF par Marcel Arland, encore présent à la mémoire de Beauvoir, vingt ans après, quand elle écrira le Deuxième Sexe : Amour, terre inconnue, de Martin Maurice – roman et auteur aujourd’hui parfaitement oubliés. Habent sua fata libella. L’autre méthode consiste à réévaluer une notion qui serait à tort passée inaperçue dans l’esthétique de Bataille, ou dont l’importance aurait été mal jugée. C’est ce qu’ont tenté, chacune de son côté, mais aboutissant à des résultats analogues, deux jeunes chercheuses, dans deux thèses récentes, qui tentent de relire Bataille sous la lumière du sublime. De sa thèse Claire Lozier vient de tirer un ouvrage : De l’abject et du sublime (Peter Lang, 2012), dont un long chapitre porte sur Bataille (les autres écrivains abordés sont Genet et Beckette). De la thèse que Céline Sangouard-Berdeaux a soutenue en janvier 2012, un article donne un aperçu : l’instant privilégié dont Bataille parle en 1939 dans son article « Le Sacré », et qui lui semble le but de la recherche menée par les écrivains modernes, la nécessité de l’angoisse et du déchirement dans la littérature et dans l’expérience intérieure, l’exaltation du saisissement et du ravissement – voilà ce qui révélerait chez Bataille « une sorte de sublime d’intensité » fait de « force, contraste et violence ».
Je ne suis pas certain que ces deux analyses tiennent suffisamment compte du champ socio-économique dans lequel Bataille a conscience d’écrire, lui qui notait vers 1930 : « les valeurs sublimes […] sont devenues inutiles en temps ordinaire au développement industriel et commercial » ; apparaissant comme « inconciliable avec la pratique de l’exploitation capitaliste », elles auraient dès lors été liquidées sans état d’âme. Je me demande surtout comment le sublime peut s’accommoder du refus de toute élévation icarienne chez Bataille, de sa préférence déclarée pour un « bas matérialisme », et enfin du rôle capital qu’il impartit au rire – « rien de sublime ne peut exister dans l’homme sans qu’il soit nécessaire aussi d’en rire » -, et aussi, on l’a vu, au dégoût. Et pourtant… souvenons-nous de l’analyse que Michel de Certeau donnait du rapport entre pourriture et sublime dans la mystique : « la pourriture du sujet est la condition pour qu’il y ait institution théâtrale de « la toute-puissance en sa pureté». De même que la destruction de la dignité humaine est pour les mystiques le commencement de l’exposition au divin, de même que les « “guenilles” velues et roses » de Mme Edwarda font voir un autre Dieu, ou le Dieu qui est « tout autre », de même chez Bataille le dégoûtant conduirait au sublime ?
C’est ce genre de questions vertigineuses qui attache à Bataille. Et aussi à la littérature, telle du moins que continue à la définir, dans son sillage, Christian Prigent : « comment penser l’expérience littéraire en dehors de la notion d’expérience des limites ? » Limites de notre expérience : la science et l’existence, la loi et la chance, le dégoût et le sublime ?